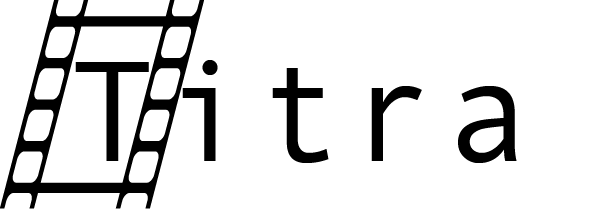Le sous-titrage pour les sourds et malentendants

Si le sous-titrage est utile aux gens d’horizons linguistiques différents, il est essentiel pour toute une partie de la population mondiale : les sourds et les malentendants. En Suisse, on dénombre près de 10’000 sourds et 900’000 malentendants. L’ignorer serait ignorer 1/8 de la population.
Une nécessité
Pour les sourds et les malentendants, le sous-titrage est le lien avec le 7ème art leur permettant de rêver devant une aventure, de trembler devant un policier ou de s’amouracher devant une romance. Comme nous le faisons tous grâce au contenu audio. Il est donc essentiel que des sous-titres soient disponibles pour cette discrète – pourtant large – partie de la population.
Réalisation du sous-titrage
Le sous-titrage pour les sourds et malentendants, abrégé SM, est de manière générale réalisé dans la langue d’origine d’une production audiovisuelle. Les étapes du sous-titrage sont les mêmes que pour tout autre type de sous-titres. Malgré tous les efforts de réalisation de sous-titres SM, ces derniers sont souvent des synthèses de ce que nous entendons – tout comme le sous-titrage en langue étrangère – car le contenu audio ne peut être retranscrit tel quel : il doit respecter la vitesse de lecture du téléspectateur. Par ailleurs, les sous-titres ne peuvent excéder les 36 caractères par lignes, deux lignes au maximum.
En ce qui con concerne le contenu audiovisuel diffusé en direct, le sous-titrage doit être réalisé en temps réel par des professionnels, appelés vélotypistes, ou par un logiciel informatique retranscrivant le contenu audio (en dépit de la qualité). Notons qu’il existe plusieurs types de format.
Le closed captioning ou charte de sous-titrage
Les sous-titres pour les sourds et les malentendants répondent également à un code couleur spécifique permettant d’identifier différents types d’information retranscrits. Ce procédé permet une meilleure compréhension du contenu audiovisuel pour les personnes présentant une déficience auditive. On distingue donc :
- Le blanc, lorsque qu’il s’agit d’une prise de parole simple par un personnage
- Le jaune, lorsqu’un personnage parle hors-champ
- Le magenta pour les indications musicales
- Le rouge pour les indications de bruit
- Le cyan pour la retranscription des pensées ou les voix off
- Le vert pour les retranscriptions dans une langue étrangère.